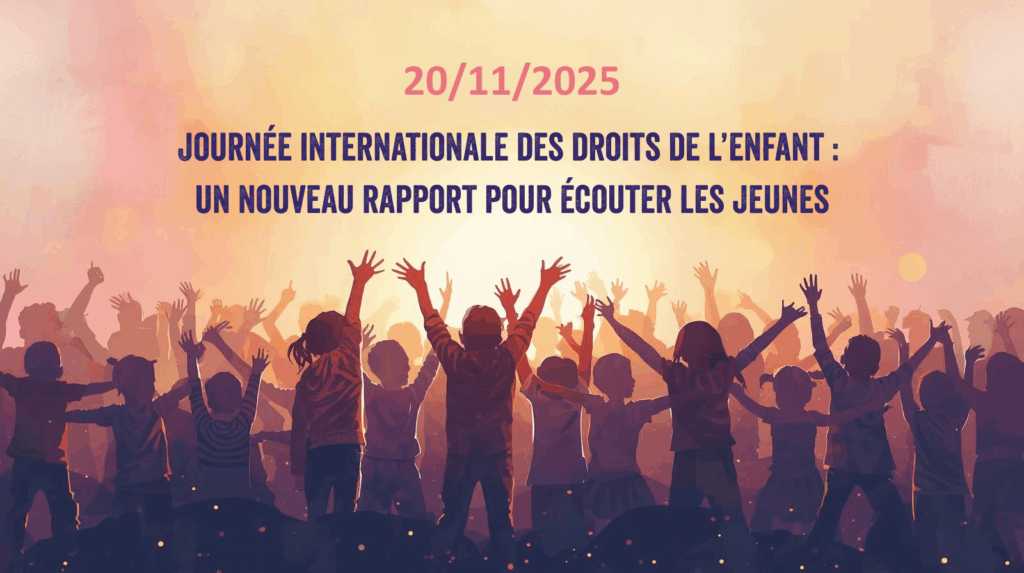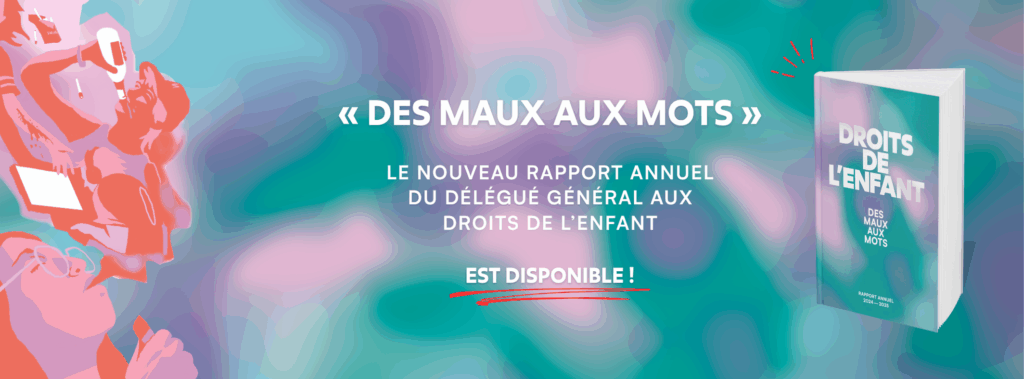En ce 20 novembre, Journée internationale des droits de l’enfant, il nous semblait essentiel de revenir sur un événement marquant qui s’est tenu il y a quelques jours : la présentation, le 18 novembre, du nouveau rapport annuel du Délégué général aux droits de l’enfant, « Des maux aux mots », consacré à la santé mentale des enfants et des jeunes.
Cette date symbolique, dédiée aux droits fondamentaux de tous les enfants, donne une résonance particulière à ce rapport qui met en lumière leurs réalités, leurs difficultés… mais surtout leur droit à être entendus.
Dans la matinée du 18 novembre, l’hémicycle du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vibrionnait au rythme des paroles de jeunes venu·es de tous horizons, rendant la présentation du rapport particulièrement intense et porteuse de sens. Le choix du lieu n’est pas anodin : un espace de décision démocratique, où leurs voix ont réellement été entendues.
Pourquoi ce rapport est si important
Le rapport 2024-2025 met la santé mentale des enfants et des jeunes au cœur de son propos — un thème d’une urgence criante selon le Délégué général, Solaÿman Laqdim, et qui traverse toute la société.
Selon des chiffres cités dans le rapport (et relayés par les médias), 16,3 % des jeunes de 10 à 19 ans présentent des troubles psychiques avérés ; par ailleurs, 37 % disent rencontrer des difficultés psychologiques. C’est un signal d’alarme : le mal-être chez les jeunes n’est pas marginal, il s’amplifie.
Le rapport pointe aussi des facteurs de risque sociaux : la précarité, la discrimination (liée au genre, à l’origine, à l’orientation sexuelle) ou encore l’isolement. Le Délégué insiste : on ne peut pas seulement soigner des symptômes ; il faut agir sur les déterminants sociaux de la santé mentale.
Un moment fort, porté par les jeunes
L’événement de remise du rapport a été particulièrement marquant :
Le Conseil des jeunes a pris la parole avec force et courage, ce qui illustre le principe fondamental de participation : donner aux jeunes un espace réel pour s’exprimer.
Plusieurs associations et collectifs étaient représentés : Realism, l’ASBL Un pass dans l’impasse avec le projet « Écho de vie », le collectif Tout va s’arranger (dont un film poignant réalisé par Pierre Schoobroodt avec le Centre d’Action Laïque et la FAPEO), etc.
Des témoignages personnels ont aussi enrichi la matinée : notamment celui d’Arthur Verhasselt, qui a parlé de harcèlement et de santé mentale, avec des recommandations très concrètes.
Même des jeunes élèves du Lycée Guy Cudell étaient présents, ainsi que des familles : ça montre que la question dépasse les « experts » ; c’est un vécu, une réalité partagée.
Des recommandations concrètes
Le rapport ne se contente pas de décrire les problèmes : il propose aussi des pistes d’action :
Investir dans les services de prévention : plus de soutien psychosocial, des structures accessibles, des échelles d’écoute dès le plus jeune âge.
Agir sur les déterminants sociaux : lutter contre la pauvreté, la discrimination, l’isolement qui impactent la santé mentale des jeunes.
Renforcer la coordination entre les secteurs : santé, aide à la jeunesse, éducation… Le Délégué appelle à plus de cohérence institutionnelle pour ne pas laisser les jeunes « incasables ».
Donner la parole aux jeunes comme acteur central : non seulement comme bénéficiaires mais comme partenaires dans la construction des politiques.
Pourquoi cet article sur notre site ?
Pour nous, c’était essentiel de porter ce moment sur notre plateforme :
Parce que la santé mentale des jeunes est une priorité collective : ce n’est pas uniquement un dossier « jeunesse », mais un enjeu de société.
Parce que les jeunes doivent être entendus : leur participation à l’élaboration ou la présentation de ce rapport est une belle preuve que la démocratie participative peut être vivante et efficace.
Parce que les recommandations du rapport peuvent inspirer nos actions, que ce soit dans nos projets, nos partenariats, nos politiques internes.